Dans l’article : “Racines et Culture” je me réfère aux Grecs qui désignaient du même mot les notions de “greffé” et de “c!vilisé”. Cette assertion est assez étonnante pour que l’on s’interroge, que l’on gratte le badigeon pour découvrir le chevêtre. La racine indo-européenne “k*el” (quenouille) donne en grec : se trouver habituellement dans.., tourner en rond.. , mais aussi “polein” tourner et “polos” pivot vers colus en latin “colère, cultus “habiter, cultiver, à la campagne, fermier et colon vers “cultura” (Culture de la terre et Civilisation. Éducation = Maîtrise et dépassement de la Nature) L’homme civilisé (donc éduqué) c’est celui qui se greffe lui-même en vue de produire des fruits plus nourrissants et plus savoureux disent les Grecs. Le mot “greffe” du grec “graphein” = “écrire”, “graphé”= écriture, “Civilisation, Culture” s’opposent à “état de nature”, à “barbarie”, L’inscription se distingue par une incise de la matière, par l’adoption d’une altérité remarquable, son incorporation et son appropriation, Le coin dans l’argile, le stylet sur le papyrus, le burin dans la pierre, la plume sur le papier, le calame aussi, comme le scion (cet étranger) greffé sur l’arbre inscrivent pareillement la différence de l’écriture et du développement, pour une meilleure cueillette (même famille que lecture ! ) sur l’arbre (même famille que livre) de l’humaine connaissance.
Tout cela peut paraître un peu tiré par les cheveux, bien que rigoureux ! ! On voudra bien en faire une lecture métaphorique ou parabolique. Le Progrès est peut-être dans l’aitération au sens que donne Proust à ce mot : “…la Langue éprouve de temps en temps le besoin de ces altérations de sens des mots, de ces raffinements….”, l‘altération étant l’accueil de l’autre (alter), de l’étranger, de la greffe rapportée. Peut-être que, alors, pleins d’usage et raison , nous saurons, sans racinisme, mieux cultiver notre jardin. J’ai plaisir à penser, que de l’indo-européen : quenouille, qui désigne un des premiers outils de la civilisation ( seuls les barbares se vêtent de “peaux de bêtes”! ) au mot Culture, le lien est plus symbolique ou métaphorique qu’étymologique. Le mot “quenouille” a disparu comme désignant un outil mais il perdure sous la forme de “Culture”, manifestation et condition de la “Civilisation”.
Heuristique & Sémiologique
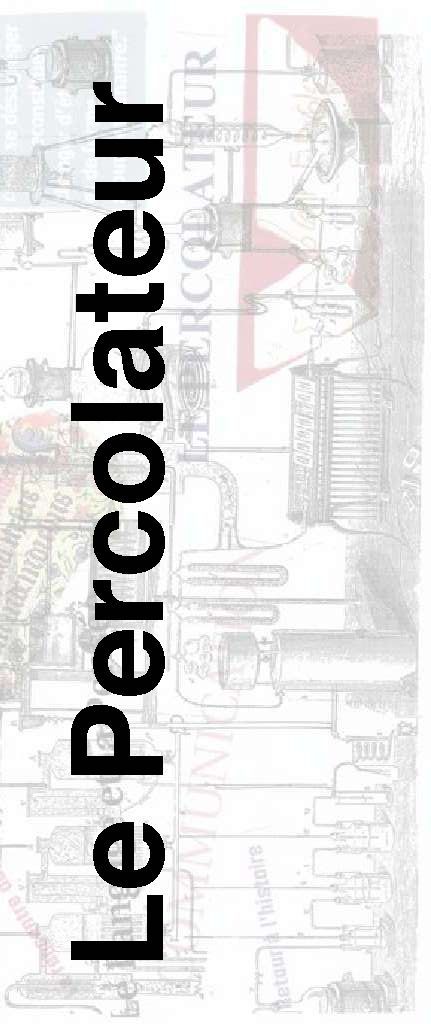
L’altération : accueil de la Greffe.
Désordre créateur, point de vue d’un “manager”
…Il a le cerveau en feu, le manager, quand son esprit divague ainsi et fait des aller-retours entre les vices et les vertus de l’ordre et du désordre. Mais comment peut-il faire pour expliquer à ses équipes qu’elles doivent respecter les règles jusqu’à la moindre virgule quand lui-même est convaincu que le désordre de son bureau l’oblige à une veille permanente et salutaire ?
Comment peut il convaincre ces collaborateurs de s’engager sur des méthodes reconnues et efficaces basées sur l’ordre et le rangement (5S en milieu industriel par exemple), en ayant la crainte permanente d’appauvrir le potentiel créatif de son organisation ?
Comment peut-il promouvoir ces méthodes, véritables chemins tracés sans ignorer la richesse des voies détournées ?
Pourquoi ne rien laisser au hasard alors que le hasard est source de progrès, de nouveauté, d’évolution ?
Il se souvient, le manager, de ses lointains cours de mécanique des fluides où le professeur faisait remarquer avec malice que le régime turbulent est beaucoup plus efficace dans les échanges thermiques avec l’extérieur que le pauvre régime laminaire…
Le manager doit mettre en place une organisation apprenante, culturellement tournée vers le changement, capable d’auto-organisation. Il doit en être le régulateur, pas l’ordonnateur.
L’ordre c’est la contrainte, les directives, la hiérarchie, la routine, l’ennui, l’inertie, le contrôle, la certitude, les normes et finalement l’assoupissement.
Le désordre c’est la rapidité, les turbulences, la nouveauté, le changement, l’imprévu, le renouvellement, les risques, le doute, l’autonomie, la liberté, et finalement le progrès.
Opposer ces deux notions est stérile, le manager vient de réaliser que son rôle est de gérer ce mélange subtil d’ordre et de désordre, mélange qu’on appelle complexité…
Le manager sourit, le triste état de son bureau lui a encore inspiré des idées nouvelles…
Rédigé le 03/11/2007 à 17:35 dans Le management.
Extrait du site du Manager “L’INDÉLOCALISABLE”
Où est passé le cultivé ?
“La culture est ce qui reste quand on a tout oublié” (E. Herriot). “Être cultivé, c’est se cultiver”. La Culture se définit là, comme trace, empreinte et ici, comme processus d’enrichissement ontologique. Décidément il nous faut interroger l’histoire du mot et du concept qu’il nomme, d’autant qu’il désigne souvent en ces temps, la façon de vivre et ses coutumes, ses habitudes, chape identitaire et uniforme tribal.
Le lien entre culte et culture (même origine latine : colere) existait à l’époque romaine, leur proximité et leur cousinage se fondaient sur cette origine commune et sur la notion de développement. On développait, comme une marque d’honneur, on cultivait la relation aux dieux par le culte, puis le développement de la nature végétale et celui de l’esprit par la culture, cultura. Dans les langues modernes, le travail de la terre l’emporta, mais l’Humanisme de la Renaissance redécouvrit la dimension métaphorique : on cultive l’esprit pour en cueillir les fruits. Dans “l’Humanisme intégral”, Jacques Maritain définit “la Culture comme le développement moral, le développement des activités spéculatives et des activités pratiques (artistiques et éthiques) qui mérite d’être appelé en propre un développement humain“. Recherche du chevêtre sous le vernis ou le badigeon.
L’ethnologie a beaucoup utilisé le terme de “culture” et, le banalisant, a favorisé l’amalgame avec manière de vivre, partage de valeurs, coutumes,… La sociologie, la presse et les médias usent, abusent du terme et le dévoient : culture jeune, culture de banlieue, black, beur, urbaine, rurale ou rurbaine, bobo ou paysanne … laissant sur les bas-côtés de la dérive le mot “cultivé”. ( La sociologie s’intéresse à juste titre à ces notions, mais il faudrait relire Bourdieu !).. Pour se démarquer de la pipolisation ambiante, culture et civilisation sont conduits à se confondre, partageant le même centre d’intérêt : l’épanouissement de la vie proprement humaine, dans toutes ses dimensions, La Culture peut, ainsi, tenir un autre discours, plus exigeant, plus Humaniste que celui concédé par notre époque démagogique et ségrégationniste.
Le point “Vélique”
Je lis Alain Rémond depuis très longtemps, depuis l’époque de sa collaboration à Télérama. Maintenant chaque semaine, dans Marianne, je me délecte de la lecture de sa chronique, pour son style, son humour et pour son art de découvrir le détail qui illustre le tout, la facette-miroir du polyèdre gyroscopique de notre société. Dans le dernier numéro de Marianne “la voile (lui) donne des vapeurs”, il nous présente et commente la définition officielle et administrative du “VOILIER” élaborée par le Ministre de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables, Jean-Louis Borloo. Alain Rémond nous avertit “c’est du sérieux, du costaud”. Vous êtes prêts ? On y va.
«Sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion principale est vélique, à condition que As 0,07 (m LDC) 2/3, m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes et As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts~dehors, queues-de-malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu’à l’étal le plus avancé,fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ12, où I et j sont les mesurages entre la face avant du mât, l’extrémité arrière de l’étal et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n’est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l’exception des mâts-ailes.”
Aïe! dans le jargon administrativo-technocratique, un voilier c’est bien autre chose qu’un bateau à voiles ! ! Alain Rémond, a toujours soin de son lecteur : “je vous autorise à sortir prendre l’air pendant quelques minutes” OUF ! MERCI !… Cela dit lors de la saisie du texte mon correcteur a peu rougi, la plupart de ces mots marins ( ! ) figurent dans les bons dictionnaires. Il en est un qui me plaît beaucoup : VÉLIQUE = des voiles ( 1727) confirme Le Robert précisant que “le point vélique” est le centre de la voilure, là où s’applique la résultante des forces du vent ( un peu comme le centre gravité ou le barycentre). Son usage métaphorique intéresse beaucoup le PERCOLATEUR, se référant à cette citation de Victor Hugo ; ” le point vélique d’un navire c’est le lieu de convergence, endroit d’intersection mystérieux pour le constructeur lui-même où se fait la somme des forces éparses dans toutes les voiles déployées. Paris est le point vélique de la civilisation..”. Vélique caractérise un endroit mais aussi un mouvement de composition de forces, on peut penser que le ministre de l’Ecologie appréciera l’usage métaphorique et hugolien de ce mot du lexique marin !
Le FRANÇAIS, la Science et la Technique
Le FRANÇAIS , la Science et la Technique. Du “fax” à la “télécopie” !
On peut, par rapport à la Langue, avoir des exigences spécifiques selon les domaines (poésie, récit, théâtre,…) qu’elle doit servir. S’agissant de la Science et de la Technique, elle doit permettre de communiquer toute information de nature scientifique et technique quel que soit le domaine d’étude, c’est-à-dire de décrire de manière précise, concise et complète un phénomène, une observation, une entité vivante ou inerte, un appareil et son fonctionnement, un concept, une théorie ou un raisonnement et d’en justifier l’existence. D’un point de vue purement linguistique, cela signifie que la langue possède le vocabulaire nécessaire et suffisant, une syntaxe précise et que chaque stéréotype de phrase ne peut être utilisé que dans une seule et même acception pour tous. Ainsi se définit le concept de “norme” qui est étroitement lié à celui de “créativité”. La structure linguistique, et le respect des règles qui la constituent, ne peuvent se manifester qu’à travers les actes linguistiques des locuteurs qui mettent en oeuvre les règles. Ainsi la créativité linguistique apparaît-elle comme la norme linguistique elle-même, qui consiste dans le jeu normal des règles constitutives du systèmes de la langue. Elle est essentiellement la norme du locuteur en tant que producteur d’énoncé. Elle se distingue de la norme de l’interlocuteur qui interprête l’énoncé du locuteur et qui relève les déviations qui peuvent s’y glisser, qui formule un jugement d’acceptabilité. C’est la collectivité parlante ou une certaine fraction de cette collectivité qui exerce un contrôle, qui constitue un frein contre les déviations du système. Toutefois, la science et les techniques évoluant, les scientifiques et les ingénieurs ont fréquemment besoin de nouveaux termes et de nouvelles désignations. Une langue scientifique et technique doit leur fournir les ressources pour construire les mots nouveaux et leur assurer un maximum de transparence. C’est-à-dire que les mots nouveaux, idéalement, doivent pouvoir être associés immédiatement et naturellement aux sens ou aux nouveaux concepts qu’ils représentent et, ainsi, en assurer facilement la diffusion aussi bien que la vulgarisation. La conséquence immédiate de cette observation est qu’il est toujours préférable de forger un mot nouveau à partir des ressources de la langue que de l’emprunter d’une autre sans adaptation puisque le mot étranger ne pourra jamais être spontanément compréhensible.
Récemment, Alain Rey dans un entretien avec le Nouvel Observateur déclarait : “La langue est une machine de créativité dont on ne se sert pas assez. On pourrait à partir du Français fabriquer des mots nouveaux indiscutables, bien formés et compréhensibles par tous.” Il est extrêmement surprenant d’entendre, de la bouche de prétendus spécialistes de néologie et de terminologie française, que l’anglais forme plus facilement que le français des nouveaux mots pour désigner les objets des nouvelles techniques de communication et d’information, par exemple. En effet, surtout dans ce domaine, l’anglais a fréquemment recours à des sigles et des acronymes qui, sur le plan linguistique, ne sont que des béquilles, des mécanismes maladroits de création de nouveaux mots. La prolifération de ces acronymes et sigles et leurs champs sémantiques sont tels que même les spécialistes des disciplines concernées doivent souvent avoir recours à des dictionnaires spécialisés. De plus, même dans la terminologie n’impliquant pas des acronymes ou des sigles, les nouveaux mots et désignations anglo-américaines sont souvent incompréhensibles par le non spécialiste. “Pour le non informaticien, par exemple, des termes tels que “ middleware ” ou “ data mining ” ne veulent strictement rien dire et même la proportion d’informaticiens les comprenant est loin d’atteindre une majorité” constatent nos amis du Québec qui nous donnent souvent l’exemple d’une créativité lexicale efficace. Il est vrai qu’ils savent “qu’un mot emprunté est rarement rendu” !
On peut préférer : “TÉLÉCOPIE” à “FAX” ! ! !
Racines et Culture, pour une botanique critique !
Racines et Culture, pour une botanique critique ! !
Il m’arrive de temps en temps de fouiller dans mes vieilles notes de lecture, fragments souvent difficiles à déchiffrer, bribes et citations…C’est ainsi que récemment j’ai inventé (parce que découvert) des notes et des photocopies de pages de livres dans une liasse de papiers que j’avais intitulée : “fondement et racines”, une centaine de feuilles qui peuvent peut-être alimenter mon “percolateur”, d’autant que j’y trouve une citation qui ne manque de me séduire (tant elle résume la notion de percolation) : “Chez les grecs le même mot signifie “greffé” et “civilisé “. Ce ne sont pas les racines qui comptent, mais les modifications qui leur sont faites de leur déterminisme, le changement introduit au niveau du tronc et des branches : pour des fruits différents. C’est aux fruits qu’on juge l’arbre pas au racines. Les racines c’est barbare….la culture est l’ensemble des greffons, des modifications du déterminisme des racines. Le racinisme d’aujourd’hui traduit une perte du sens grec de la culture.”
Et si parler de« racines» à propos des humains n’était qu’une méprise d’étymologie, une confusion des plantes végétales avec la plante des pieds? La plante des pieds ne prend pas racine comme une plante. Curieusement, la plante des pieds, dans la langue, a précédé la plante «végétale », qui est une création tardive du français. Aussi la marche à pied, pour le mot « plante », est-elle bien plus originaire que l’enracinement. La plante est d’abord des pieds, c’est-à-dire de la marche; puis elle donne « planter» : enfoncer avec le pied, tasser la terre avec le plat du pied, d’où « planter» au sens actuel; et finalement le mot passe à ces végétaux nés du plantage : du déplacement et du travail de la plante des pieds. La dignité de l’originaire étymologique est du côté du pied humain, et non du végétal ! Et on vient nous parler de « racines» et d’ « enracinement », nous dire que nous sommes des végétaux comme un emblème suprême de l’archaïque. Escroquerie! C’est le déplacement, la marche, le non-enracinement de la plante des pieds, qui sont fondateurs!
Le racinisme s’est exprimé dans la Révolution française avec une phrase idiote autant que célèbre: “On n’emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers ” Ce qui est une diffamation caractérisée de la plante des pieds. Et qui est évidemment faux : quand les semelles des expulsés de la guillotine se réfugient dans les forêts de Germanie, on parle d’expatriés et d’ « émigrés» ; mais lorsque la dynamique de la Révolution propulse les semelles des patriotes jusqu’à Moscou, alors très bien! Quand il s’agit des adversaires, on dit : “anti-patriotes ! vous voyez, ils s’en vont ! “Quand il s’agit d’exporter la Révolution, on dit: “En fait je ne m’expatrie pas, car ma patrie, c’est le monde. ” Escroquerie. L’homme est cette plante qui se dépote elle-même et qui emporte tout à la semelle de ses souliers: la patrie et le reste.
Une méprise étymologique certes, mais surtout anthropologique, ontologique, un contre-sens conceptuel.
NB 1:Je n’ai retrouvé ni le titre du livre, ni le nom de l’auteur. A en juger d’après la position des documents dans la pile poussiéreuse, je pense que le livre date des années 1980 ? ( je suis demandeur d’informations ! )
NB 2 : On peut se rendre à la page : “le chêne et le rhizome” (encore de la botanique)
André Gorz et Dorine sont partis.
André Gorz et Dorine sont partis.
André Gorz et sa femme Dorine se sont suicidés. La survie de l’un ou de l’autre leur apparaissait inacceptable. Hier (24/9/2007), sur la porte, un message “prévenir la gendarmerie“, ils reposaient côte à côte. Il avait 84 ans et elle, 83 ans. Depuis le 23 octobre 1947 ils ne se sont jamais quittés. Pendant soixante ans, elle a été présente auprès de lui. Présence décisive, si l’ŒUVRE du philosophe ne porte qu’un nom, ce fut celui d’un couple, le fruit d’un long dialogue. Depuis sa rencontre avec Sartre en 1946 jusqu’à “L’immatériel’ (Galilée 2003), André Gorz s’est attaché “à intégrer à la philosophie morale et existentielle, une dimension sociologique et économique”. En septembre 2006 il a publié son dernier livre : “Lettres à D. Histoire d’un amour.” (Galilée) qu’il a “écrit en pleurant”, disant la passion et la reconnaissance qu’il avait pour Dorine. Belle Histoire.
 Coup de dé :
Coup de dé :