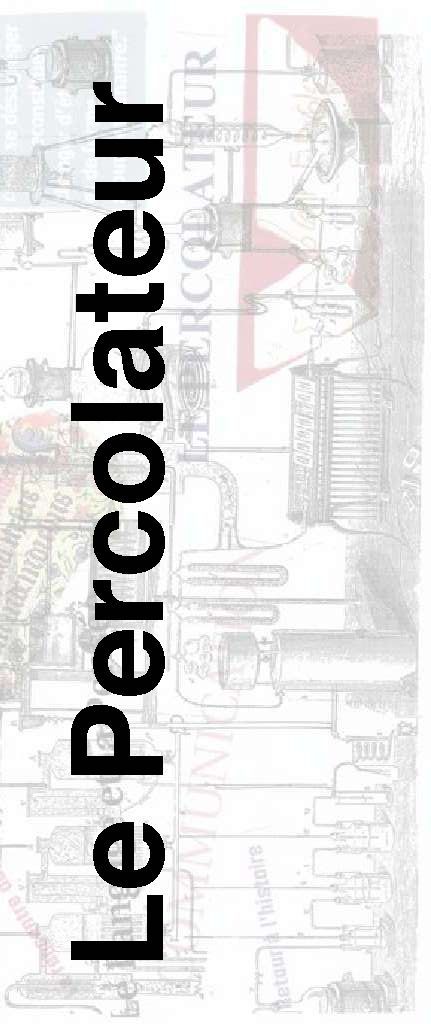Méta-style.
Après avoir produit le texte “Style” (Webzette n°15, page “invention”) j’ai découvert, au hasard d’une relecture de “Vues” de Paul Valéry “La Table Ronde” un texte qui abordait ( avec un style bien meilleur que le mien !) la question du STYLE (1945). Je vous le propose :
STYLE, ce nom si pur de figure et de son… serait un nom charmant de quelque être choisi, d’un oiseau rare, d’un personnage de féerie. Il est d’entre ces noms dont la qualité musicale fait rêver d’un langage dont les mots sonneraient leurs sens. Mais non. STYLE, d’abord, fut un poinçon. Aux doigts des Vîrgiles, et des Tacites, il gravait sur la cire mince et noire des tablettes ces illustres vers, cette prose fameuse, dont une part nous fut con~ servée par miracle. Ce poinçon plus tard se fit plume, et la cire, papier. Mais avant même que la pointe dure et traçante l’eût cédé au bec souple d’une rémige taillée, le nom de STYLE avait passé de l’instrument à la main qui le mène, et de la main à l’être dont elle tient le mode et le pouvoir de faire tout ce qu’elle fait.Ces glissements successifs d’idée en idée sous le même terme développent insensiblement la poésie propre du langage.
STYLE signifie donc la manière dont quelqu’un s’exprime, quoi qu’il exprime, cette manière étant considérée comme révélatrice de sa nature, abstraction faite de sa pensée actuelle, – car la pensée n’a point de style. C’est dans l’acte de l’expression que la personne se marque. On y trouve ses rythrnes singuliers, les constances nerveuses de son caractère, ses ressources verbales plus ou moins originales, ses procédés familiers et ses entraînements ou ses réserves qui s’observent et se retrouvent dans la diversité de ses discours écrits ou parlés. Tout ceci fait son style. Mais, parmi tout ceci, n’oublions pas que se glisse et domine parfois, curieusement introduite et agissante, la faculté de dissimulation et de simulation.
Ce n’est donc point le seul esprit appliqué à une action particulière qui donne le style; c’est le tout d’un système vivant qui se dépense, qui s’imprime, qui se fait reconnaissable dans l’expression. Cela est mêlé de conscience et d’inconscience; de spontanéité et de recherche; parfois de calcul. Une reuvre ou une action peut être accomplie avec science ou vec art, et ne pas accuser de style. Une certaine négligence n’est pas ennemie du style; mais une attention, même excessive, est loin de l’exclure. chez les uns, la volonté perce, et dénonce l’énergie soutenue de leurs desseins; chez les autres, l’abandon se livre, et il est style; et il en est qui cultivent leur abandon, dont ils n’ignorent pas qu’il peut avoir valeur de style.
Mais la manière de faire caractéristique de quelqu’un, son style, n’est pas toujours louable. n y a de méchants styles. Quand ce mot est pris en bonne part, il dit quelque chose de plus que manière d’être ou de faire, et il n’est pas facile de préciser ce ” quelque chose”. Je crois qu’un beau style implique une sorte d’organisation de la singularité, une harmonie qui repousse l’excès de la fantaisie. L’extravagance la bizarrerie débordent le beau style. Le caprice non tempéré ne lui sied point. Tout le monde convient que le tigre est d’un tout autre style que le singe: il a des équilibres magnifiques; l’autre n’est qu’ins-
tabilité, gambades vaines, bonds sans but.
Le beau style doit faire songer à une loi très sensible, mais indéfinissable, qui relève le caractère trop individuel des actes ou des oeuvres et leur communique la dignité de type ou de modèle. Une personnalité prend alors l’intérêt d’un original, d’un exemplaire unique qui se distingue dans cette collection de semblables qu’est l’espèce humaine, comme un écart vers un idéal.
Rien n’est plus dénué de style que ce qui est le produit d’une fabrication mécanique ou imitable. Je déplore donc (mais il est trop tard) l’emploi de notre mot pour désigner une époque ou une école d’architecture ou d’art ornemental, car les styles de ce genre sont définissables et imitables; et il est arrivé que l’abus commercial de cet abus verbal nous a valu l’expression ” meubles de style” qui promet ce que l’on sait.
–
~
 Coup de dé :
Coup de dé :