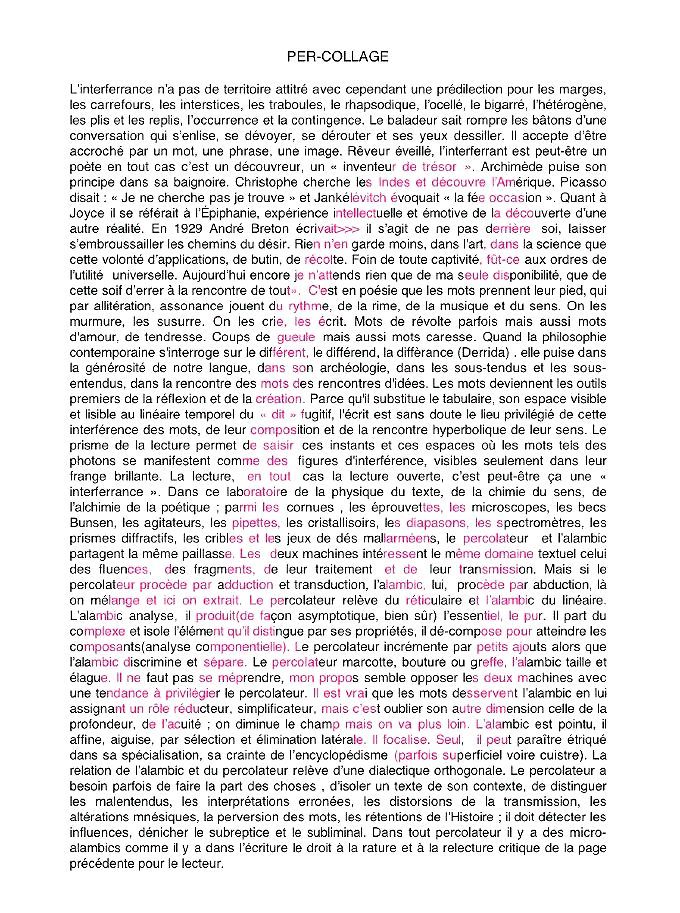L’abbé Grégoire (1750-1831), curé constitutionnel, fut chargé par la Convention Nationale d’établir un Rapport sur l’Universalisation de l’usage de la Langue Française qu’il présenta à l’assemblée révolutionnaire le 16 prairial an II.
Ce Conventionnel, ardent républicain, fit un véritable plaidoyer pour cette Langue de la France Républicaine susceptible de révéler le Droit au PEUPLE et de lui ouvrir la route de la Liberté. Cette langue, héritière de nombreux idiomes, d’un passé prestigieux (parfois prostituée aux intrigues des cabinets, qui en avait repéré les qualités) passionnait Grégoire qui était aussi linguiste, étymologiste, sociolinguiste, dialectologue (pardonnez les anachronismes). Rationnaliste, il conduisit la mission qui lui était assignée avec une rigueur toute scientifique, s’appuyant sur le réseau des Paroisses et des Curés de France pour établir un état des lieux, c’est ainsi qu’il fut conduit à préconiser la généralisation de l’apprentissage du Français (la langue des maîtres) à tous les enfants de la République, mais aussi la suppression des dialectes locaux (langues de la servilité et du Babélisme désorganisateur) pour un Progrès de la Liberté et de l’Echange généralisé (Egalité et Fraternité). Cependant Grégoire reconnaît que la connaissance des dialectes peut “jeter du jour sur quelques monuments du Moyen-Age”.
“Ainsi la philosophie qui promène son flambeau dans toute la sphère des connaissances humaines, ne croira pas indigne d’elle de descendre à l’examen des patois, et dans ce moment favorable pour révolutionner notre langue, elle leur dérobera peut-être des expressions enflammées, des tours naïfs qui lui manquent. Elle puisera surtout dans le Provençal qui est encore empli d’hellénismes et que les Anglais même, mais surtout les Italiens ont mis souvent à contribution.”
Presque tous les idiômes rustiques ont des ouvrages qui jouissent d’une certaine réputation. Déjà la commission des arts, dans son instruction, a recommandé de recueillir ces documents imprimés ou manuscrits ; il faut chercher des perles jusque dans le fumier d’Ennius.
Ainsi Grégoire nous apparaît comme une référence possible en notre temps qui s’interroge sur la fracture sociale, sur le déclin de notre langue ,de son enseignement et de sa pratique, sur les notions de Liberté et d’Egalité. Notre Langue Française est exigeante de respect, de soin et d’attention mais c’est aussi un recours dans notre quête de Justice.
Heuristique & Sémiologique
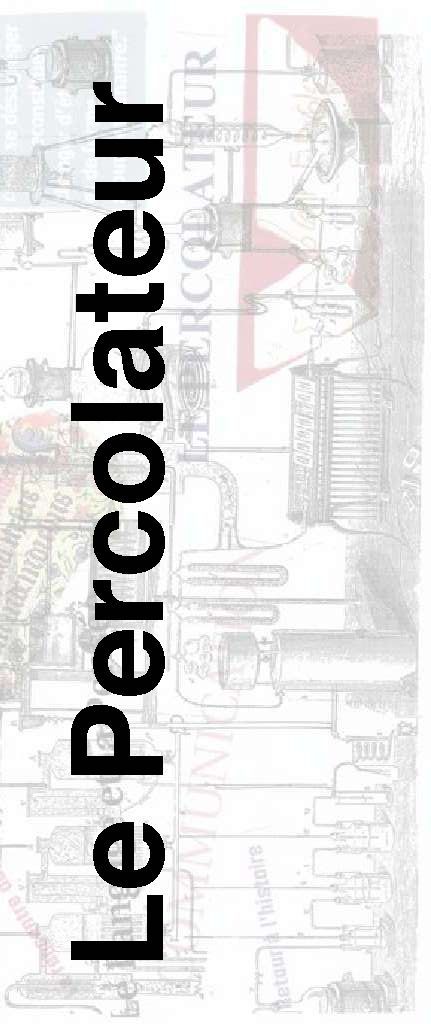
L’abbé Grégoire
La Liste incrémentale et percolatrice ! !
Bible Homère Thalès Socrate Platon Aristote Lucréce Virgile Paul Augustin Abélard Thomas d’Aquin Villon Rabelais Montaigne Descartes Vaugelas Pascal Newton Spinoza Leibniz Kant Rousseau Diderot Hegel Marx Proudhon Fourrier Comte Bernard Nietzsche Tarde Mallarmé Rimbaud Valéry Saussure Bergson Péguy Poincaré Alain Braudel Bachelard Aron Sartre Merleau Ponti Mounier Tardieu Joyce Heidegger Breton Alchinsky Barthes Cobra Jankélévitch Neumann Simondon Levi Strauss Leroi Gourhan Lacan Girard Queneau Pérec Oulipo Michaux Morin Foucault Wittgenstein Goody Christin Deleuze Peignot Steiner Eco Derrida Ricoeur Genette Serres Dagognet Debray Stiegler Rey.
Syllabaire coréen
Métamorphoses
Boulevard Saint Michel, pour acquérir l’objet de leur étude, deux gamins timides et typés maghrébins jettent leur dévolu sur l’enseigne Maxi-Livres, présumé par eux meilleur marché. “Vous avez Les Métamorphoses d’Ovide, s’il vous plaît ?”
La vendeuse s’éclipse, revient, déplore : “non, mais j’ai La Métamorphose de Kafka”. Dépités,les deux ados semblent ne pas bien comprendre. (La vendeuse non plus, d’ailleurs). Extrait de la rubrique Rebonds de Libération 06/03/07.
Arbitraire et mimétisme
Arbitraire et mimétisme.
La linguistique postule “l’arbitraire du signe”, la déconnexion du mot et de la chose ; la poésie en découvre des parentés, des analogies, des imitations. des complicités. Là, la rigueur de la science, ici, la fantaisie ludique du poëte. Il n’empêche que Saussure le savant s’adonnait subrepticement à des recherches sur ses anagrammes qu’il ne considérait pas comme sérieuses à tel point qu’il ne les a pas publiées ( elles ne le furent qu’après sa mort ). Certes “le mot chien ne mord pas”, ni le mot chat ne griffe mais le chien ABoie et le chat MIAUle ! Il y a de l’onomatopée bien sûr et souvent aussi de la mimographie (le V de vase). Souvenons-nous du léZard de Ponge sur son mur léZardé et son Zig-Zag furtif, ce mimétisme du mot et de la chose se manifeste tout aussi bien du point de vue phonique que graphique comme le S de serpent ou le T de table,
“Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes”, la fameuse allitération de Racine joue sur ces deux registres, ces serpents là on les voit serpenter et on les entend siffler. Il y a 2 ou 3 ans nous évoquions dans ces colonnes la nostalgie hiéroglyphique du Y de Lyon que nous imaginions comme trace étymologique voire ontologique du Confluent. Claudel voyait dans le mot locomotive la représentation même de la machine, de sa cheminée, ses roues, ses bielles jusqu’à son tender et son crochet. On sait que les deux orthographes ” lis ” et ” lys ” sont autorisées, d’aucuns préfèrent LYS voyant dans le Y la représentation hiéroglyphique ou pictographique de la fleur !
Induit par la phonétique et le graphisme il y a entre les voyelles < i > et < a > un rapport de dimensions ; du TIC au TAC, du “mini” au”maxi”, du “pico” au “nano”, du “micro” au “macro”, “d’ici à là”, du “petit” au “grand”, du site au panorama, du proche au lointain. On discrimine ou on amalgame ! Dans la monstration, la désignation, CECI n’exige qu’un doigt pointé alors que CELA implique un geste plus ample; dans l’effusion, le bisou est aussi pointu et parcimonieux que l’embrassade est large et généreuse, le bris est moins grave que le casse ! On peut aussi évoquer dans le lexique scatologique, enfantin ou euphémique le pipi et le caca ! Il faut, bien sûr, savoir raison garder, si la souris est plus petite que le rat et le chat, le grizzli est beaucoup plus grand et beaucoup plus gros que ceux-ci !
Dans tout cet arbitraire il y a tout de même certaines motivations qui paraissent s’imposer ; c’est le cas par exemple du phonème < ST > qui s’entend comme un mouvement léger qui vient buter contre un obstacle bref mais impérieux, la sifflante contre la dentale ! Le graphème illustre de la même façon cet arrêt et ce redressement brutal, la sinuosité mouvante contre la stabilité géométrique. Dans les deux cas c’est le T qui l’emporte et qui compte, le S le prépare, l’annonce, le met en valeur, l’érige. Statue, station, statut, stable, posture, stature, statu quo, instance, existence, stèle, obstacle, statique, substance, nonobstant, prestance, stade, interstice, stand, constitution, estrade, solstice, …… Bon nombre de ces mots ont pour ancêtre l’indo-européen : STA = “être debout ” ! Ce qui explique que nous les partagions souvent avec nos cousins anglais et germains. Stop ! !
La Lettre, le Mot peuvent se manifester comme expressifs presque naturellement. Le texte par contre, pour s’affranchir de la contrainte linguistique, rejoindre et figurer son sens, doit se soumettre à un parti-pris graphique de l’auteur, comme dans les calligrammes d’Apollinaire ou au talent (mimique) du comédien-lecteur. Le rapprochement des voyelles et de la couleur fascine légitimement les poètes : Rimbaud voyait le A en noir et Hugo en blanc, inconciliable, à chacun sa palette, la symbolique colorée des sons reste, semble-t-il, du domaine poétique personnel, rebelle. Les langues elles-mêmes n’échappent pas à la tentation de l’approche mimétique : le soleil produit les voyelles comme il produit les fleurs, le Nord se hérisse de consonnes comme de glaces et de rochers. L’équilibre des consonnes et des voyelles s’établit dans les langues intermédiaires, lesquelles naissent des climats tempérés. (V. Hugo) . Mais c’est un poète qui parle, pas un linguiste !
L carminé sur fond de textes
Paradoxe informatique
L’opérateur à l’ordinateur :
– Donne-moi un palindrome de la langue Française.
L’ordinateur de répondre ;
– NON.
Proposé par J.L. Thévenot. (Blois)
Note de la webzette : Un palindrome est un mot ou un groupe de mots qui peut être lu indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche sans changer de sens ; comme “rêver”, …”élucide l’édicule”. Les surréalistes, l’OULIPO n’ont pas manqué de s’intéresser à ce jeu de langage. Georges Pérec emporte la palme avec un palindrome de 5000 mots. Dans l’histoire courte qui nous est proposée, un créateur de logiciel linguistique veut tester son “découvreur de palindromes” ! ! Concluant ? !
 Coup de dé :
Coup de dé :